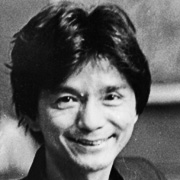
(1927-1991)
T’ang Haywen est un peintre chinois ayant vécu et travaillé à Paris. T’ang Haywen appartient à la seconde génération d’artistes chinois qui s’installe en France après la Seconde Guerre mondiale, comme Chu Teh-Chun et Zao Wou-Ki. L’art de T’ang Haywen est façonné par la calligraphie et les principes du taoïsme.
Œuvres
Pour recevoir des informations sur les œuvres disponibles de T’ang Haywen,
merci de NOUS CONTACTER.
Expositions
Jeunesse et formation de l’artiste T’ang Haywen
T’ang Haywen (nom de naissance Zeng Tianfu) naît le 20 décembre 1927 à Xiamen en Chine, dans la région de Fujian. Il déménage à 10 ans dans l’actuel Ho Chi Minh Ville au Vietnam.
À l’instar de ses contemporains, les peintres Chu Teh-Chun et Zao Wou-Ki, T’ang Haywen se rend en France pour poursuivre sa formation artistique. Contrairement à Chu Teh-Chun et Zao Wou-Ki, le peintre T’ang Haywen ne reçoit pas d’éducation artistique à l’Académie de Hangzhou. C’est en effet grâce à ses connaissances en calligraphie et sur le taoïsme inculqué par son grand père qu’il se développe intellectuellement et artistiquement.
Le peintre chinois T’ang Haywen à Paris
En 1948, T’ang Haywen se rend en France pour étudier la médecine, selon le souhait de sa famille. Il abandonne cependant cette formation et prend des cours à l’Académie de la Grande Chaumière. À Paris, T’ang Haywen étudie les œuvres de Gauguin, Cézanne et Matisse dans les musées. Dans ses premières œuvres, il explore différents thèmes : la décoration intérieure, les portraits, les autoportraits, les natures mortes et les vues de Paris.
Sa fascination pour le peintre individualiste du XVIIe siècle Shi Tao influence beaucoup son oeuvre. En 1958, le peintre T’ang Haywen écrit à son frère : « J’ai trouvé ma vocation dans la peinture… je ne pensais pas que cela puisse plaire à nos parents… c’est une affaire très grave, où il ne peut être question, honnêtement, de chercher la réussite pour elle-même… La réussite doit, pour être véritable, être tout à fait sincère. Une fois qu’un peintre s’est trouvé, alors il peut travailler pour les autres, il le doit, mais il ne peut pas le faire avant… Je ne pourrais ni ne veux abandonner cette vocation. »
Les encres du peintre T’ang Haywen
Dès le début des années 1960, T’ang Haywen montre une préférence pour l’encre sur papier, la gouache et l’aquarelle. Ce peintre définit alors un espace pictural original et personnel en utilisant du carton de taille standard. Il travaille d’abord sur des formats 29,7 x 21 cm et 70 x 50 cm, puis double ces formats pour créer des diptyques. On retrouve très souvent dans l’œuvre du peintre T’ang Haywen le format 70 x 100 cm.
Les inspirations du peintre chinois T’ang Haywen
En 1964, T’ang Haywen peint Hommage à Cézanne sur un papier de 70 x 50 cm. Dans cette œuvre, il revisite la composition des Grandes Baigneuses.
De 1960 à 1965, il peint une série de très petites huiles, dont la plupart sont faites sur du papier journal. Alors que l’huile est le médium privilégié des artistes occidentaux, l’utilisation du papier journal révèle les conditions de vie modeste de l’artiste.
En 1968, T’ang Haywen peint un grand diptyque : un groupe de trois femmes nues aux cheveux et à la peau foncée, inspirées de Gauguin, rappelant son plus grand travail : D’où est-ce que nous venons ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ?. Au verso de l’œuvre, le peintre chinois écrit d’ailleurs : « d’où venons-nous ? ».
T’ang Haywen & le cinéma
Au début des années 70, T’ang Haywen est invité par le Maharani de Porbandar à Goa en l’Inde. Sur la plage de Goa, il rencontre le réalisateur Tom Tam et sa partenaire Marta Sandler. T’ang Haywen apparaît alors avec Marta dans le court métrage psychédélique Furen Boogie. En 1973, Tom Tam et T’ang Haywen créeront à Paris dans son petit appartement de la rue Liancourt, probablement le premier film d’art par un artiste chinois moderne : T’ang Boogie.
Les expositions du peintre chinois T’ang Haywen à travers le monde
Dans les années 1970 et 1980, les voyages et les expositions s’enchaînent pour T’ang Haywen. En 1975, la conservatrice Mary Tregear expose les peintures à l’encre de T’ang Haywen au Ashmolean Museum d’Oxford. T’ang Haywen est aussi exposé plusieurs fois chez Nane Stern à Paris et dans d’autres galeries en Suisse, en Italie et en Allemagne. Sur recommandation d’un ami, il rencontre la célèbre collectionneuse Dominique de Ménil aux États-Unis qui fait l’acquisition d’un diptyque de T’ang Haywen.
La calligraphie et la peinture chinoises utilisent les mêmes outils : pinceaux ronds sur papier ou soie, encre et eau. On pourrait penser que ces œuvres sont abstraites, pourtant les artistes chinois Zao Wou KI, Chu Teh Chun et T’ang Haywen ne se considèrent pas comme des peintres abstraits. En 1972 T’ang Haywen écrit d’ailleurs : « … Il ne fait aucun doute que les jeux abstraits peuvent inspirer la pensée des gens en un instant, mais au moment de déchiffrer et de comprendre le passé, la sensibilité n’est plus prospère, les nombres sont morts et les souvenirs ont même disparu. Notre sensibilité profonde, liée à l’inconscient, ne peut se développer et grandir que nourrie par le tangible, c’est-à-dire, en ce qui concerne la peinture, par le rappel dans notre mémoire consciente d’expériences sensibles profondes et durables vécues par nous dans le monde réel. C’est à partir d’une certaine figuration matérielle plus ou moins prépondérante que la peinture peut se développer, se renouveler sans se perdre, et se déployer dans les domaines de l’affectivité et de la spiritualité… »
Au début des années 1980, Tang Haywen continue de créer des diptyques dans divers formats, dessinant de petits triptyques à l’encre et en couleur et de nombreuses petites aquarelles. Sa vie devient plus simple et ses recherches spirituelles le rapprochent d’un groupe d’amis, dont la galeriste Nane Stern. T’ang Haywen se rend à cette époque à l’abbaye de Fontgombault. Il se convertit au catholicisme et est baptisé en 1984 sous le nom de François, ce qui signifie « homme libre ».
Entre 1983 et 1984, grâce à son ami Dominique Ponnau, le peintre T’ang Haywen expose ses œuvres au musée de l’Académie des beaux-arts de Quimper en Bretagne et au Musée du château de Vitré. Les grands diptyques sont peints sur des cartons en fibres de bois. Certains de ses amis l’encouragent à choisir un médium plus noble. T’ang Haywen commence alors à peindre sur du papier Arches, fait de fibres de coton et connu pour sa solidité.
T’ang Haywen continue de voyager et d’exposer ses peintures en France et à l’étranger. Son dernier grand voyage l’emmène en Géorgie, mais sa santé se détériore. Atteint du SIDA, il décède le 9 septembre 1991 à Paris.
Reconnaissance posthume du peintre chinois T’ang Haywen
À la fin des années 1990, les peintures de l’artiste T’ang Haywen commencent à être connues du grand public. Plusieurs expositions importantes, notamment au Musée Maritime de Monaco, au Musée des Beaux-Arts de Taipei, au Musée Jimei et à la Fondation Shiseido à Tokyo, montrent l’importance et l’originalité de son travail.
© Galerie Diane de Polignac

© T’ang Haywen, photo par Yonfan Manshih, 1991
Collections (sélection)
Collections (sélection)
Brive, Musée de Brive
Chambéry, Musée des beaux-arts
Chicago, IL, Art Institute of Chicago
Hong Kong, M+ Museum,
Houston, TX, The Menil Collection
Nice, Fonds de la Direction des Musées de la Ville de Nice
Nice, Musée d’Art contemporain de la Ville de Nice – MAMAC
Paris, Musée d’Art moderne de Paris
Paris, Musée national des arts asiatiques Guimet
Paris, Musée Cernuschi
Pontoise, Musée de Pontoise
Quimper, Musée des beaux-arts
Sables d’Olonne, Musée de l’Abbaye de Sainte Croix
Vitré, Musée de Vitré
Washington D.C., Académie nationale des sciences
Expositions (sélection)
Expositions (sélection)
Galerie Voyelles, Paris, 1955
Galerie Belvédère, Hergiswil am See, Lucerne, 1956, 1968
Galerie Belles Images, Rabat, 1958
École des Beaux-Arts, Casablanca, 1959
Musée de Montréal, 1959
Galerie 7, Poitiers, 1960
Galerie Bradtke, Luxembourg, 1960
La Galerie St Ferdinand Pimlico, Paris, 1960
Galerie Talleyrand, Reims, 1961, 1966
Galerie Librairie « La Boîte à Livres », Tours, 1962
Galerie Raymond Creuze, Paris, 1963
Alaska Methodist University, Ancrage, 1963, 1965
Mairie de Saint Valéry en Caux, 1964
Galerie Welter, Paris, 1964
Galerie Kezek, Megève, 1965
Galerie Creuze, Paris, 1965
Midsommargården Cultural Centre, Stockholm, 1965
L’Association des Jeunes Artistes, Oslo, 1965
Artist in residence at Ekely, la maison d’Edward Munch, Ekely, 1965
Galerie Galaxie, Détroit, MI, 1965
International Art Center, Détroit, MI, 1965
Jefferson Gallery, La Jolla, 1966
Galerie Plaisir de France, Los Angeles, CA, 1966
Palm Springs Museum, CA, 1966
Galerie Schmitt, Metz, 1966
Galerie de Beaune, Paris, 1968
Galleria Cittadella, Ascona, 1968
Galleria Rialto, Venise, 1968
Colegio de Arquitectos de Cataluna y Baleares (Espagne), 1968
Roland, Browse & Delbanco Gallery, Londres, 1970
Galleria del Vantaggio, Rome, 1971
Grange de Meslay, Tours, 1971
Galleria d’Arte San Luca, Bologna, 1972
Galleria del Vantaggio, Rome, 1972
Galerie Jacques Davidson, Tours, 1972
Cambridge Arts Centre, Cambridge, 1972
Musée de l’Abbaye de Sainte Croix, Sables d’Olonne, 1972
Galerie de L’Armitière, Rouen, 1973
Kunstgården, Skovby (Danemark), 1974
Galleria Tonino di Campione, Campione (Italie), 1974
Galerie Nane Stern, Paris, 1975, 1978, 1982, 1986
Ashmolean Museum, Oxford, 1975
Galleria Costellazione, Gêne, 1975
Jacques Baruch Gallery, Chicago, 1976
Galerie du Manoir, La Chaux-de-Fonds (Suisse), 1977
Galerie 21, Zurich, 1979
Musée Savoisien, Chambéry, 1979
Galerie Jacques Davidson, Tours, 1979
Galerie Daniel Abras, Bruxelles, 1979
Musée de la Ville de Nice, 1979
Galerie des Ponchettes, Musée de Nice, 1980
Schmuck Galerie, Augsburg (Allemagne), 1981
Bibliothèque Municipale, Graulhet (France), 1981
Lola’s Art Galleries and Studio, New York, 1981
Galerie Gisèle Linder, Bâle, 1982
L’Académie nationale des sciences, Washington D.C., 1983
Musée des beaux-arts de Ernest Rupin, Brive, 1983
Musée des beaux-arts de Quimper, 1983
Galerie Gisèle Linder, Bâle, 1983
Millioud Gallery, Houston, TX, 1983
Galerie Jacques Davidson, Tours, 1983
Artistes Chinois de Paris, Mairie Annexe du 6ème Arrondissement, Paris, 1983
T’ang, Soixante-dix lavis, acryliques et aquarelles, Musée du Château, Vitré, 1984
Musée des beaux-arts, Vannes, 1984
Galerie Schumacher, Zwingenberg, 1984
Théâtre municipal de Beauvais, 1984
Bürgerzentrum, Château de Borbeck, Essen, 1985
Maison de la Culture de Bottrop-Oberhausen, 1986
Maison de l’Amérique Latine, Paris, 1987
Orangerie de Landecy, Genève, 1987
Galerie Aras, Saulgau (Allemagne), 1988
Galerie de la Poste, Pont-Aven, 1988
Atelier Pierre Olivier, Lyon, 1989
Musée National d’Art moderne – Centre Georges Pompidou, Paris, 1989
Galerie Le Sacre du Printemps, Bruxelles, 1990
HO Gallery, Hong Kong, 1995, 1997, 1998
Musée Océanographique de Monaco, 1996
Exposition itinérante de la collection Xub Aizhai, Hong Kong Museum of Art ; Singapore Art Museum ; British Museum à Londres ; Museum fur Ostasiatische Kunst à Cologne, 1996
La Tao de la Peinture – T’ang Haywen, Une Rétrospective, Taipei, 1997
Alisan Fine Arts, Hong Kong, 1997, 2016
Maîtres de L’Encre : Chang Dai-Chien, T’ang Haywen, Zao Wou-Ki, Musée de Pontoise, 1999
T’ang Haywen, Les Chemins de l’Encre (Rétrospective), Musée Guimet, Paris, 2002
Les Chemins de l’Encre (Rétrospective), Shiseido Gallery, Shiseido Foundation, Tokyo, 2002
Le dernier voyage (L’Ultimo Viaggio), Centre Culturel Saint Louis de France, Rome, 2006
Encre et Tao : T’ang Haywen, Musée Ferenc Hopp des arts d’Asie de l’Est, Budapest, 2007
T’ang Haywen, Encres & Aquarelles, Yishu 8, Maison des arts à Pékin, 2011
Le Souffle venu d’Asie, Abbaye de Beaulieu, Centre d’art contemporain, 2011
Brise de Paris, Eslite Gallery, Taipei, 2014
Bibliographie (sélection)
Bibliographie (sélection)
Eros Bellinelli, T’ang, Edizioni Panarie, Lugano, 1974
Jean-François Jarrige, Jean-Paul Desroches & Philippe Koutouzis, Les Chemins de L’encre, Éditions de la Pointe, 2002
Faq tang Haywen
Sur la page FAQ TANG HAYWEN retrouvez l’ensemble des questions et des réponses dédiées à l’artiste peintre d’art moderne Tang Haywen.







